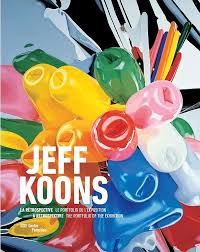Fino al 27 aprile
En partenariat avec le Whitney Museum of America Art de New York, le Centre Pompidou présente la première rétrospective majeure consacrée, en Europe, à l’oeuvre de Jeff Koons prenant pour la première fois la mesure complète de l’oeuvre de l’artiste américain, de 1979 à nos jours.
Sculptures et peintures, venues du monde entier, composent cette rétrospective dont le parcours chronologique met en évidence les différents cycles du travail de l’artiste, depuis les premières oeuvres conçues dans une veine héritée du Pop art, aux oeuvres actuelles dialoguant avec l’histoire de l’art. Avec une présentation en avant-première de nouvelles créations de l’artiste américain, l’exposition présente aussi ses oeuvres les plus connues, qui sont devenues parmi les « icônes » les plus célèbres de l’art de notre temps, notamment Rabbit (1986), Michael Jackson and Bubbles (1988), Balloon Dog (1994-2000) et la série d’aquariums Equilibrium (1985).
Jeff Koons est devenu l’un des artistes contemporains les plus connus, importants, tout en demeurant parmi les plus controversés. Depuis 35 ans, il explore de nouvelles approches du « readymade » et de l’appropriation, jouant de la lisière entre culture des élites et culture de masse, poussant les limites de la fabrication industrielle et changeant le rapport des artistes au culte de la célébrité comme aux règles du marché.
En 1987, sous l’impulsion du grand Walter Hopps, directeur de la Menil collection de Houston, le Centre Pompidou réunissait dans une exposition de groupe au titre affriolant – « Les Courtiers du désir » – cinq artistes dont un homme jeune de trente-deux ans, enchanté de cette participation : Jeff Koons. En 2000, dans une exposition de groupe intitulée « Au-delà du spectacle », j’invitais au Centre Pompidou, avec la complicité du non moins grand Philippe Vergne, un homme mature de quarante-cinq ans, toujours enchanté d’intervenir : Jeff Koons. Aujourd’hui, l’institution consacre, sous l’égide de Scott Rothkopf et moi-même, un homme mûr de cinquante-huit ans, encore plus enchanté de cette rétrospective : Jeff Koons. Vingt-sept années ont passé depuis que Rabbit s’en est venu au Centre Pompidou et en est – hélas – reparti. L’auteur de la fameuse baudruche en inox est devenu l’un des artistes les plus célèbres et les plus controversés de la scène de l’art contemporain. L’un de ceux sur lequel les phrases les plus âpres vont bon train, au point qu’on se demande si c’est encore l’œuvre qu’il s’agit de juger ou la mythologie d’un homme devenu un personnage.
Cette rétrospective entend faire le bilan d’un indéniable « grand œuvre », désormais indissociable de celui qui l’a façonné. Car le projet de Jeff Koons est, avant tout commentaire, une histoire et un rêve américains. Une œuvre pragmatique et résolument positive, un défi joyeux dans un monde de hauts et de bas, une vision certes ludique, mais plus subversive qu’il n’y paraît et que son auteur se garde de le dire. Intimement lié à sa pratique, Jeff Koons aura, au fil de quelque trente-cinq ans, plus d’une fois défrayé la chronique. Des premiers objets résolument enfantins aux figures archétypales en acier polychrome se dressant dans les institutions publiques et les fondations privées, des images publicitaires métamorphosées en tableaux aux cadeaux d’entreprise devenus les trophées des meilleures ventes publiques, des publicités pour « master classes » gratifiées à des enfants attentifs dans des magazines d’art aux images pornographiques incarnant, pour l’artiste, « l’amour et la spiritualité », l’œuvre de Koons n’aura cessé de défier le jugement et le goût et de stimuler le désir pour affirmer sa valeur iconique et symbolique.
Il fallait cette première rétrospective européenne au Centre Pompidou pour juger sur pièces. Il apparaîtra ainsi au visiteur que l’artiste n’a cessé, au fil d’un travail obsessionnel, d’associer artisans et fabricants à la réalisation de pièces techniquement toujours plus ambitieuses. Des premiers assemblages cherchant une synthèse entre pop et minimalisme aux moulages de plâtre ornés de décorations pour parcs et jardins, Koons a voulu inscrire son projet au fil de séries dont les sujets parlaient à tous pour tenter de réconcilier l’art moderne et la culture populaire dans une célébration des contraires enfin réunis.
Car l’ambition de l’artiste est de taille. Et pas seulement immense. Même si Koons, on le sait, ne dédaigne pas le poids physique, symbolique et majestueux du monument. Son ambition est, en fait, de prendre en défaut les paradoxes d’un discours théorique qui n’aura, au fil de la modernité, souvent trouvé de justification que dans l’opposition qu’il aura cru entretenir avec le pouvoir. C’est là pour Koons un défi, voire un retournement.
Plusieurs décennies ont passé. L’Amérique a été ébranlée et Jeff Koons semble avoir gardé un irrémédiable optimisme. Intégrité et authenticité, acceptation de soi et dialogue, confiance et responsabilité : il y a sans doute dans la pratique de Jeff Koons du Dale Carnegie et de sa méthode pour « se faire des amis et influencer les gens ». Et si la promesse de bonheur tant de fois prise en défaut trouvait à s’accomplir, il n’est pas impossible que notre artiste veuille en être le porteur. Enjoy !
Par Bernard Blistène, directeur du musée national d’art moderne
Bernard Blistène – Les artistes de Chicago – assez méconnus en Europe et en France – ont été très importants pour vous. Pourriez-vous nous en parler ?
Jeff Koons – À l’époque où j’étudiais dans une école d’art, je suis allé un samedi après-midi au Whitney Museum. Mon école se trouvait dans le Maryland : j’ai pris le train pour New York et j’ai vu une exposition de Jim Nutt. C’est un « imagiste » de Chicago. Ses peintures étaient si nouvelles pour moi! Il exposait des travaux des années 1960 et 1970. Il y avait des peintures sur Plexiglas, avec un côté pop, mais elles avaient aussi un fort potentiel narratif, quelque chose d’un peu surréaliste. En tant que jeune artiste, il était logique pour moi de comprendre comment développer sa propre iconographie, tout en la reliant au pop art et en instaurant un dialogue plus ouvert avec le monde extérieur. J’ai fini par déménager à Chicago, où j’ai retrouvé Jim Nutt, et nous sommes devenus amis avec Ed Paschke, que Jim assistait dans son atelier. Ed Paschke est un autre artiste qui a exercé une immense influence sur moi. Il m’a aidé à comprendre que l’on peut créer un dialogue, des racines profondes, une iconographie personnelle, que l’on peut commencer à toucher au domaine de l’objectif.
BB – Tout cela constitue les racines américaines de votre travail ?
JK – Ce sont les artistes qui m’ont aidé à dépasser mon attachement à dada et au surréalisme pour développer une iconographie personnelle, comprendre les sentiments et la manière dont on peut faire ressentir certaines sensations au public, et pour me rendre compte que je voulais m’aventurer plus loin. Après avoir passé du temps à Chicago, je suis retourné à New York, car j’avais besoin d’une connexion plus forte à l’art européen, entre autres à Fluxus, qui m’intéressait… Je voulais me faire le défenseur d’idées dans leur forme pure.
BB – Vous citez souvent Fluxus et son influence sur votre travail ou sur votre processus de création, mais je dois dire que physiquement, visuellement, il n’y a aucun rapport entre le travail de vos débuts et ce que Fluxus faisait au même moment.
JK – Cela a peut-être à voir avec une certaine avant-garde. Avec Fluxus, on trouve cette tradition de l’avant-garde et des artistes qui sont dans la revendication, qui croient à la revendication, qui créent leur propre réalité.
BB – Mais vous n’avez jamais fait cela. Ou peut-être au début ?
JK – Quand j’ai fait mon lapin gonflable [NDLR : Inflatable Flower and Bunny (Tall White, Pink Bunny), 1979] et mes fleurs gonflables, c’était peut-être dans une optique similaire. Mais il suffisait d’être conscient de ce genre de choses, des dialogues, ou de parler avec d’autres jeunes artistes de l’époque. Je désirais que mon travail ne se fonde pas sur l’art subjectif, sur ce dont j’avais rêvé la nuit précédente, je désirais qu’il relève d’un langage plus universel.
BB – Mais vous vous souciiez davantage de faire une alliance entre pop et minimalisme. Vous étiez plus impliqué dans les grands mouvements naissants de la culture américaine…
JK – Je suis d’accord. Mais j’étais pourtant conscient de tout ce qu’ils faisaient : George Maciunas, Ben, Yoko Ono, et bien d’autres.
BB – Quand vous évoquez ce type de mouvements, vous parlez d’avant-garde. Vous répétez souvent que l’avant-garde demeure très importante pour vous. Qu’attendez-vous d’elle ? Vous sentez-vous vous-même, pour ainsi dire, un artiste de la « néo-avant-garde »?
JK – Je me sens lié à l’avant-garde, absolument. Moi qui ne savais rien sur l’art, qui n’avais aucune connaissance en histoire de l’art, je suis tout à coup allé dans une école d’art, j’ai acquis ces fondamentaux, j’ai compris comment les artistes peuvent s’impliquer dans leur communauté, partager des idées, débattre, créer leur propre réalité. On peut créer sa propre vie, vous savez. On peut changer son univers et celui de sa communauté. C’est une manière de vivre, de croire sincèrement en quelque chose. C’est ainsi que j’ai commencé à définir l’avant-garde. Je voulais donc y prendre part. Cela signifie partager, dialoguer, participer à ce dialogue… […]
BB – L’avant-garde a toujours été «contre», contre quelque chose, contre la société, le système politique, la conjoncture. Elle a essayé de changer la marche du monde, d’une certaine manière. Votre travail est en opposition absolue avec cela.
JK – Mon travail est contre la critique. Il combat la nécessité d’une fonction critique de l’art et cherche à abolir le jugement, afin que l’on puisse regarder le monde et l’accepter dans sa totalité. Il s’agit de l’accepter pour ce qu’il est. Si l’on fait cela, on efface toute forme de ségrégation et de création de hiérarchies. […]
BB – Vous vous trouvez à New York à la fin des années 1970. Pourriez-vous nous parler du contexte dans lequel vous avez commencé à exposer votre travail ?
JK – Lorsque je suis arrivé à New York pour la première fois, j’étais un étranger, complètement dans la périphérie. Quand j’ai conçu mes fleurs gonflables, ou les œuvres utilisant des éponges, il pouvait arriver que quelqu’un comme Richard Prince ou bien Holly Solomon, qui était galeriste à New York, vienne dans mon atelier, mais cela restait une exception. Je pensais que mes premières réalisations révélaient trop ma propre sexualité; je pensais que créer quelque chose d’objectif reviendrait à abandonner tout ce qui me serait associé. C’est alors que j’ai réalisé « The New ». Cette série utilisant des aspirateurs a été exposée dans plusieurs lieux alternatifs dont Artists Space et White Columns, donc toujours en périphérie. Personne ne m’achetait rien. J’ai dû rentrer chez mes parents et habiter chez eux. Quand je suis revenu et que j’ai commencé à m’imposer, la scène artistique de l’East Village se mettait en place. […] J’avais roulé ma bosse, et, pour la jeune génération, j’avais une certaine crédibilité. Je suis revenu à ce moment-là, et je me suis dit : « Si je dois partir de New York, je suis fichu », vous saisissez? J’ai repris pied, je suis revenu et j’ai exposé la série « Equilibrium ». C’est alors que les choses ont commencé à avancer pour moi.
BB – Pour de nombreuses raisons, vous êtes un artiste figuratif. Pourriez-vous nous l’expliquer ?
JK – J’aime la forme de communication qu’induit l’art figuratif : les gens, moi-même, pouvons nous identifier aux formes. C’est la vie humaine, la façon dont nous interprétons les choses, ce n’est pas une forme d’abstraction, cela implique notre corps et notre esprit. Je pense que j’ancre systématiquement les choses dans la vie, pour améliorer notre expérience personnelle. Je souhaite améliorer la mienne. Je veux avoir une vie plus vaste, plus ample, vivre des expériences plus profondes. Je ramène donc toujours mon travail à ce que signifie être humain. Comment pourrais-je évoluer de façon plus signifiante ?
BB – Pouvons-nous alors vous définir comme « artiste figuratif » ?
JK – Oui. Je travaille avec des éléments très figuratifs. Dans l’ensemble, je pense que mon travail est abstrait, de par la manière dont il fonctionne, autour de nombreuses notions. Mais j’incorpore effectivement beaucoup d’éléments figuratifs, et j’aime cela, car ils me permettent de communiquer.
BB – Votre processus de fabrication, qui implique notamment les technologies informatiques et la participation d’un atelier important, est de plus en plus sophistiqué. Pourquoi cela ?
JK – J’utilise la technologie pour être certain que mon intention originale est conservée au cœur même d’un processus impliquant plusieurs personnes. […] Ainsi, je ne perds pas le contrôle de ma vision; elle peut rester fidèle à ce que j’avais imaginé. Il arrive que quelqu’un d’autre s’implique et en change la direction, généralement par souci d’efficacité et de rapidité, également par souci économique. Il s’agit de pouvoir tirer d’une chose davantage que ce que vous avez mis dedans. Emprunter le chemin le plus direct est un moyen idéal d’atteindre son but. C’est ce que j’essaie de faire autant que possible. Mais en voulant obtenir des résultats qui correspondent à mes attentes, en créant une surface pure sans altération, il est plus difficile d’emprunter ce chemin direct. […]
BB – Ce que vous appelez la « surface pure » est en rapport avec le contenu de votre travail. De telles œuvres nécessitent ce que vous appelez cette « surface pure ». C’est pourquoi vous avez à plusieurs reprises refusé certains travaux qui restaient imparfaits à vos yeux. Pourriez-vous parler de cette notion de surface des œuvres, de sa signification ?
JK – J’essaie d’aller aussi loin que possible. Quand on regarde quelque chose, on peut rester perdu dans l’abstraction pendant un temps infini. Mon premier souvenir se rapportant à cela remonte au moment où je me suis rendu dans une fonderie pour démouler ma sculpture Bob Hope. C’est une pièce en acier inoxydable, on dirait presque un Oscar, une sorte de récompense. Quand je l’ai soulevée, j’ai vu qu’ils n’avaient pas intégré le fond de la sculpture. J’ai demandé : « Pourquoi n’avez-vous pas reproduit le modèle original? » Ils ont répondu : « C’est un fond. Personne ne va le voir. » À ce moment-là, j’ai perdu confiance en tout, car je voulais pouvoir constater que le fond était bien identique à celui du modèle original. Je souhaitais que le spectateur ressente cette confiance, afin qu’il puisse s’abandonner, rester plongé dans cette transformation, cette abstraction qui est à l’œuvre.
BB – Dans une telle situation, que perdons-nous ? Le pouvoir d’imiter ?
JK – Nous perdons cette fraction de seconde qui nous permet de continuer le dialogue. Au lieu de cela, on se dit soudain : « Qu’est-ce que tout ça fait là ? » La question n’était pas de prendre quelque chose et de le transformer, cela a déjà été fait. Il s’agissait d’être là avec cet objet et de savoir que moi-même, en tant qu’artiste, je vous respecte, vous, les spectateurs et j’essaie de maintenir le dialogue. […] Voilà pourquoi je fais attention à tous ces détails, afin que vous puissiez demeurer avec l’œuvre, en faire une expérience claire et rester avec elle le plus longtemps possible.
BB – 35 ans plus tard, quel est, à vos yeux, le sujet de votre travail ?
JK – Ce que je veux dire est que tout est là. Toute chose nous entoure. Tout ce qui existe dans l’univers est là. Tout ce qui vous intéresse est là. Si vous vous concentrez sur vos centres d’intérêt, tout se présentera de soi-même, de plus en plus proche. Vous vous rendrez compte que tout est disponible. […]
BB – Même si la figure du lapin relève de vos débuts, elle revient bien plus tard, comme un artefact, ou peut-être l’un des stéréotypes de votre travail.
JK – Si je devais donner le fil rouge de mon travail depuis 35 ans, ce serait la rencontre des aspects internes et externes de la vie, la démonstration des liens entre ces deux pôles. C’est un cercle complet. La vie intérieure s’externalise et la vie extérieure s’internalise. Je parlerais aussi du dialogue avec la nature, des êtres animés et des choses inanimées, et la manière dont ils se répondent, chacun possédant sa force propre, son propre sens de l’éternel. […] La vie, d’une certaine façon, essaye d’avancer par bonds, en brûlant presque les étapes. J’évoquerais la manière dont l’inanimé, pour survivre, tire sa force de sa durabilité. J’évoquerais ce que signifie faire l’expérience d’être humain et essayer de repousser au maximum ses limites.
Commissaire : Mnam/Cci, B.Blistène
(fonte: centrepompidou.fr)